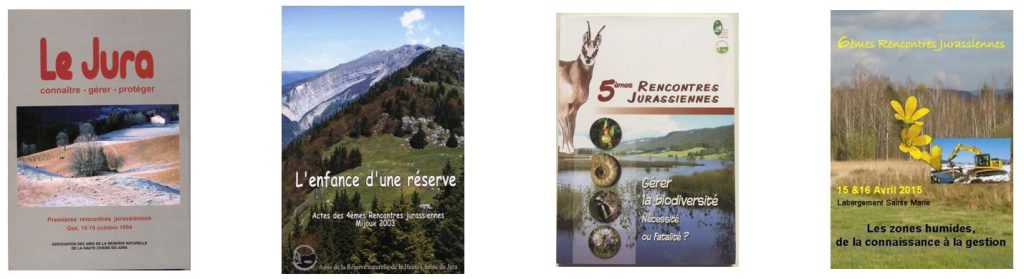attaché d’administration à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal)
Raphaël a participé au comptage des aigles sur la Haute-Chaîne au mois de mars. J’étais sur le même poste d’observation, et, les aigles ayant décidé manifestement de nous bouder, nous avons eu du temps pour échanger ! Cela m’a permis d’apprendre beaucoup de choses sur le rôle de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) pour laquelle travaille Raphaël.
Les Dreal sont des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Peux-tu te présenter ?
Je suis fonctionnaire de l’Etat attaché d’administration. Les attachés participent à la mise en œuvre des politiques ministérielles et interministérielles.
Après un master en droit européen, j’ai passé le concours d’attaché d’administration et j’ai intégré l’Institut Régional d’administration de Nantes qui forme les attachés.
Mon premier poste était à la Dreal Normandie; j’y suis resté 4 ans et j’ai travaillé sur l’évaluation environnementale, un dispositif d’information du public qui découle de directives européennes. Cette expérience m’a permis de me spécialiser sur les études d’impact.
Depuis 2020, je suis chargé de mission biodiversité à la DREAL Auvergne-Rhône Alpes à Lyon.
Qu’est-ce que l’évaluation environnementale ?
L’évaluation environnementale permet d’évaluer l’impact d’un projet privé ou d’un plan public sur l’environnement au sens très large, c’est-à-dire sur la santé humaine ; la biodiversité ; les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; les ressources naturelles et le paysage.
Cette évaluation est réalisée par le porteur de projet (plus d’infos sur Les principes de l’évaluation environnementale | DREAL Normandie (developpement-durable.gouv.fr) et doit permettre de définir les mesures d’évitement, de réduction voire de compensation permettant un impact nul du projet sur l’environnement.
Enfin, une autorité environnementale indépendante rend un avis à destination du public. Cet avis, préparé par les agents de la Dreal, est soumis à l’autorité environnementale (la Mission régionale d’autorité environnementale ou l’Autorité environnementale nationale)), pour finalisation et validation puis est présenté lors de l’enquête publique. Il vise à éclairer le public afin de ne pas montrer seulement les documents du porteur de projet, mais aussi un éclairage indépendant.
Quels types de projets as-tu été amené à évaluer ?
J’ai travaillé sur beaucoup de sujets différents : des projets de parcs éoliens, de carrières, de restauration écologique, des documents d’urbanisme, comme le PLU de la métropole de Rouen, de la ville du Havre, des plans climat-air-énergie territoriaux, des forages… On examine toutes les composantes de l’environnement, tels que la biodiversité, mais aussi le climat, l’air, le sol, la santé humaine, les paysages, donc on est attentif à ce que tous les impacts soient bien identifiés dans toutes ces composantes.
Quelles sont les missions de la Dreal ?
La direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement est l’administration régionale du ministère de la transition écologique et la cohésion des territoires. Elle comporte beaucoup de corps de métiers différents, et de missions différentes.
Il y a, par exemple, un service qui s’occupe du contrôle routier des poids lourds, un service qui s’occupe des risques industriels, des collègues qui travaillent sur le changement climatique et sur la transition énergétique, des personnes qui s’occupent des politique du logement et de l’habitat , ou encore d’eau et de biodiversité…
Une des missions de la Dreal (plus d’information : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement – Légifrance (legifrance.gouv.fr)) est de contribuer à l’information, à la formation et à l’éducation des citoyens sur les enjeux du développement durable et à leur sensibilisation aux risques.
Quel est le rôle de la Dreal par rapport à la biodiversité ?
Premièrement, la Dreal une mission d’animation de pilotage régional des politiques de biodiversité, par l’accompagnement et le financement d’un réseau d’acteur du territoire : pilotage du fonds vert biodiversité, mise à jour des listes rouges, agrément des Conservatoires d’espaces naturels et des Conservatoires botaniques nationaux, etc. Elle a en particulier la responsabilité du suivi et de l’animation des plans nationaux d’action qui suivent des espèces menacées et visent à améliorer la conservation de ces espèces. Par exemple, le Grand tétras, le Loup et le Lynx sont des espèces qui font l’objet d’un plan national d’action.
Deuxièmement, la Dreal a un rôle prépondérant pour la protection des espèces. Elle intervient dans l’instruction des demandes d’autorisation, de projets, etc., en région, dès lors qu’il y a un enjeu de biodiversité pour orienter le pétitionnaire à mieux prendre en compte la biodiversité et aussi vérifier le respect des systèmes de dérogation qui permettent dans des conditions strictes (notamment avec obligation de compensation), de détruire des habitats ou d’espèces protégées. Troisièmement, la Dreal suit les réserves naturelles nationales. En tant que chargé de mission, je suis 3 réserves : les Hauts de Chartreuse, la Haute Chaîne du Jura et les Gorges de l’Ardèche.

L’implication de la Dreal pour la gestion des réserves naturelles
Une réserve naturelle est créée par décret, et c’est le service du préfet qui fait appliquer ce décret. Lorsque l’Etat confie la gestion d’une réserve à un gestionnaire local par le biais d’une convention, la convention liste les obligations à l’égard du gestionnaire, et la Dreal s’assure que cette convention est bien respectée en toutes circonstances. Les gestionnaires locaux, qui peuvent être des établissements publics, des associations, des collectivités locales ou des groupements de collectivités, ne sont pas tous impliqués de la même manière dans la préservation de la réserve qui leur est confiée.
Pour la Réserve naturelle de la Haute Chaine du Jura, le gestionnaire local est depuis mai 2003, la Communauté d’agglomération du Pays de Gex. Vis à vis des réserves, la Dreal représente l’Etat, notamment pour ce qui est juridique, règlementaire et financier. La DREAL peut aussi accompagner de manière plus poussée les réserves dont le gestionnaire n’a pas suffisamment de moyens humains ni de ressources financières.
Une de mes missions est de participer à l’animation des comités consultatifs de la Réserve ; à l’élaboration des textes qui sont pris en application du décret, par exemple des arrêtés de zones interdites à la chasse, la réglementation de certaines activités, comme récemment sur les pièges photos…
Lorsque l’on met en place une réglementation sur les activités et manifestations sportives comme c’est le cas dans la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche, on organise une concertation avec les acteurs du monde de l’escalade, de la spéléologie, des trailers, des sports nautiques etc.
Sur la Réserve naturelle de la Haute Chaine du Jura, il y a eu par exemple une réunion avec l’ONF sur la gestion sylvicole, et sur l’impact du scolyte, qui va poser des questions réglementaires.
Gaëlle Lauby